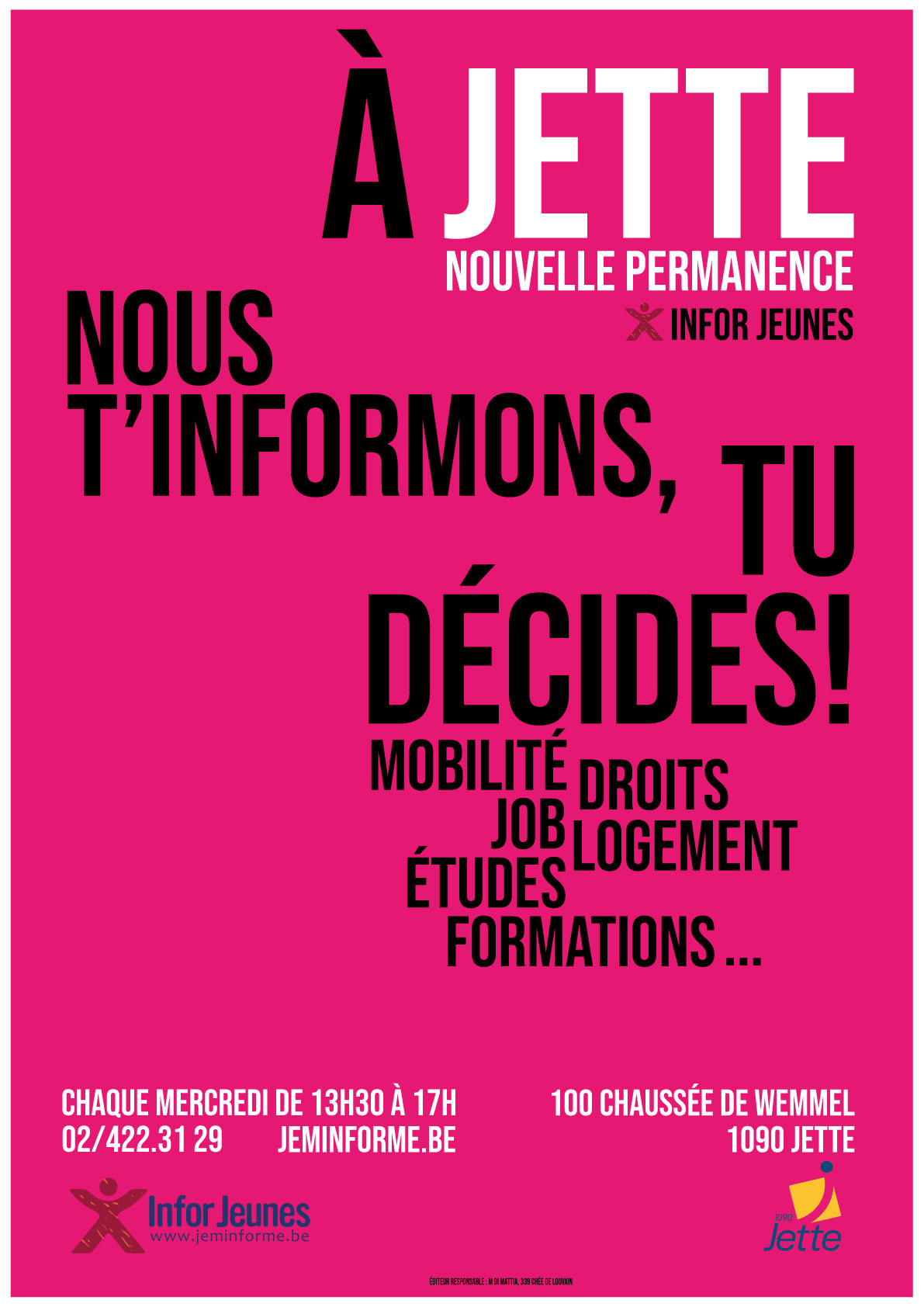L’hépatite C est une maladie du foie causée par le virus de l’hépatite C (VHC).
L’hépatite C est classée dans les IST, le mode de transmission par voie sexuelle est toutefois très rare (mais peut se produire). L’hépatite C se transmet surtout par voie sanguine.
L’hépatite C n’est pas une maladie rare. À l’échelle mondiale, on estime que 50 millions d’individus sont porteurs chroniques de l’hépatite C, avec 1 million de nouvelles infections par an. L’OMS estime qu’en 2022, environ 242.000 personnes sont mortes d’une hépatite C, le plus souvent des suites d’une cirrhose ou d’un carcinome hépatocellulaire (cancer primitif du foie). En Belgique, le nombre de personnes atteintes par l’hépatite C en 2020 s’élevait à 18 000 personnes.
Sources : OMS et Sciensano
Il ressort des données communiqués récemment à l’OMS par 187 pays que le nombre estimé de décès dus à l’hépatite virale a progressé, passant de 1,1 million en 2019 à 1,3 million en 2022 : 83% pour l’hépatite B et 17% pour l’hépatite C. Chaque jour, l’hépatite B ou C tue 3.500 personnes dans le monde. La moitié de la charge de l’hépatite B et de l’hépatite C chroniques concerne des personnes âgées de 30 à 54 ans, et 12% des enfants de moins de 18 ans. Les hommes représentent 58% des cas.
Source : https://www.who.int/fr/news/item/09-04-2024-who-sounds-alarm-on-viral-hepatitis-infections-claiming-3500-lives-each-day
Voies de transmission
Le virus de l’hépatite C se transmet principalement par voie sanguine : seringue contaminée servant à l’injection de drogue, transfusion sanguine (rare en Belgique car dépistage obligatoire des donneurs de sang), contact avec du sang infecté (tatouage, piercing, sniff, soins dentaires…). La transmission par relations sexuelles et de la mère à l’enfant est très rare.
Symptômes spécifiques
L’hépatite C est souvent appelée « maladie silencieuse » car quelqu’un qui est infecté par ce virus n’a aucun symptôme. Toutefois, chez certaines personnes, les symptômes suivants peuvent apparaître : fatigue, perte d’appétit, nausées, vomissements et douleurs abdominales.
Le stade aigu de la maladie commence dès le moment où une personne est infectée par le virus de l’hépatite C.
Si le virus de l’hépatite C est toujours présent dans l’organisme au-delà de 6 mois, la maladie entre dans sa phase chronique (fréquent pour l’hépatite C- 80% des cas). Elle se manifestera par une inflammation du foie qui s’aggravera petit à petit.
A long terme, si l’hépatite C n’est pas soignée, une cirrhose du foie peut apparaître suivie, dans certains cas, d’un cancer du foie (10 % des cas).
Diagnostic et traitement
Le médecin fait une prise de sang et un dépistage à résultat rapide afin de détecter s’il y a présence ou non du virus C.
Au stade aigu de la maladie, un traitement est possible mais en général, la maladie évolue vers une hépatite chronique. Lorsque la maladie devient chronique, il existe un traitement qui empêche la maladie d’évoluer, c’est à dire qui arrête la réplication du virus. Cela évite l’évolution vers la cirrhose du foie. Avant de commencer un traitement, le médecin vous fera une biopsie hépatique afin de vérifier l’état de votre foie.
De nouveaux médicaments antiviraux ont été mis au point, appelés agents antiviraux directs (AAD). Ils sont plus efficaces, plus sûrs et mieux tolérés que les traitements plus anciens. Un traitement avec ces médicaments permet de guérir la plupart des personnes infectées par le VHC, il est plus court (12 semaines en général) et plus sûr.
En Belgique, depuis le 1er janvier 2015, des avancées thérapeutiques ont été réalisées dans le traitement de l’hépatite C. En effet, le sofosbuvir (Sovaldi®) et le siméprévir (Olysio®) sont remboursés. Ce traitement associé à la ribavirine est nettement plus efficace et cause très peu d’effets secondaires ; on arrive à un taux de guérison complète de plus de 90%, et cela quelle que soit la souche du virus de l’hépatite C.
Depuis le 1er janvier 2019, le traitement contre l’hépatite C est remboursé.
D’autres mesures sont souhaitables : diminuer, voire supprimer sa consommation d’alcool ; surveiller son alimentation (éliminer les graisses…), se reposer souvent.
Se protéger et protéger l’entourage
Pour se protéger contre le virus de l’hépatite C, il ne faut pas utiliser tout objet susceptible d’avoir du sang infecté (seringue, aiguille de piercing, rasoirs, brosses à dent, coupe ongles, etc.). Le virus C se transmet très rarement par les relations sexuelles, mais le seul moyen d’être certain de ne pas avoir de relations à risque est d’utiliser des préservatifs (surtout pendant les périodes des règles).
Pour les usagers de drogues, mieux vaut fumer que s’injecter un produit et il ne faut évidemment pas partager du matériel (seringue, cuillère, filtre, paille à sniffer…).
Contrairement à l’hépatite B, il n’existe pas de vaccin.
Il existe d’autres hépatites : les plus fréquentes sont la A, B, C mais il y a aussi des hépatites D ou E.
Les informations ci-dessus n’ont pas la prétention d’être des informations médicales, mais de vous renseigner au mieux sur les I.S.T. qui sont souvent des maladies peu connues. En cas de doute, il faut consulter un médecin ou vous rendre dans un planning familial.
Voir aussi :
MAJ 2024