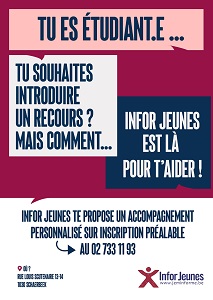Quand on parle de harcèlement, on pense souvent à ce qui se passe dans une cour d’école, un couloir, ou sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, que ce soit en ligne ou dans la « vraie vie », le harcèlement, c’est un phénomène grave, complexe, et surtout, à ne jamais banaliser.
Harcèlement VS cyberharcèlement : même combat
Avant tout, le cyberharcèlement est une forme de harcèlement. La seule différence, c’est le canal : il passe par les écrans (smartphones, ordinateurs, réseaux sociaux, jeux en ligne…). Mais dans le fond, il obéit aux mêmes règles, mêmes mécanismes. Les deux peuvent avoir les mêmes conséquences très sérieuses que ce soit pour la victime, le ou les auteurs, ainsi que les témoins.
Harcèlement : une définition simple
Dans les milieux scolaires, associatifs ou psychosociaux, on parle souvent de harcèlement quand trois éléments sont réunis :
- Une intention de nuire : même si elle n’est pas toujours clairement exprimée, la personne qui harcèle veut blesser, humilier ou mettre mal à l’aise.
- De la répétition : les actes ou propos se répètent dans le temps, ce qui rend la situation pesante ou insupportable.
- Un rapport de force déséquilibré : la personne ciblée ne parvient pas à se défendre ou à se faire entendre.
Le harcèlement, c’est donc quand une personne (ou un groupe) s’en prend de manière répétée ou non à une autre personne avec une intention de nuire : en lui faisant vivre des choses blessantes, humiliantes ou violentes, mentalement et/ou physiquement. Il y a toujours une sorte de déséquilibre : la personne harcelée se sent impuissante, sans moyen d’arrêter ce qui lui arrive.
Mais ce cadre général n’est pas toujours celui de la justice.
Le Code pénal belge interdit toute forme de harcèlement (article 442bis) passible d’une peine de 15 jours à 2 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 50 à 300€ :
« Quiconque aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou de l’une de ces peines seulement »
Dans la réforme du Code pénal belge qui rentrera en vigueur théoriquement en 2026, il n’y a plus de distinction entre le harcèlement « classique » et le cyberharcèlement. Les deux sont reconnus comme des formes de harcèlement au sens légal. Il ne sera plus nécessaire non plus que les faits soient répétés pour être condamnés.
En résumé : même un seul acte de harcèlement peut être puni par la loi, surtout si la cible se sent atteinte dans sa sécurité ou sa sérénité. C’est un signal fort : ce n’est pas la quantité qui compte, mais l’impact.
Pour plus d’information sur le cadre légal encadrant les actes de cyberharcèlement, rendez-vous sur notre article « Que faire en cas de cyberharcèlement ? ».
Il peut prendre plein de formes :
● Verbal : moqueries, insultes, rumeurs, menaces…
● Physique : coups, bousculades, jets d’objets…
● Relationnel : ignorer quelqu’un, l’exclure du groupe…
● Sexuel : blagues déplacées, photos intimes partagées…
● Matériel : vol ou dégradation d’objets…
Et le cyberharcèlement alors ?
Bien sûr, tout ce qu’on vient de dire peut aussi exister en ligne, via des messages, photos, vidéos ou commentaires.
Le cyberharcèlement, c’est donc du harcèlement via les outils numériques : réseaux sociaux, messageries, forums, jeux en ligne, etc. Il peut prendre plein de formes :
● messages insultants à répétition
● diffusion de photos ou vidéos humiliantes
● création de groupes pour se moquer d’une personne
● commentaires haineux ou discriminants
● piratage de compte pour nuire à quelqu’un
Ce qui rend le cyberharcèlement encore plus dur à vivre, c’est qu’il ne s’arrête pas à la grille de l’école : il peut nous suivre partout et tout le temps.
Qui sont les personnes impliquées ?
Le harcèlement, c’est rarement une affaire à deux.
On y retrouve généralement :
● La personne qui harcèle
● La personne harcelée
● Les témoins (car même en regardant sans rien dire, ou en aidant pas la victime, on participe !)
Un « like », un commentaire moqueur, un partage… même si c’est “juste pour rigoler”, ça peut suffire à faire partie du harcèlement.
L’harcèlement en ligne est-il plus grave que le harcèlement classique ?
Même si les mécanismes sont les mêmes, le harcèlement en ligne a quelques caractéristiques qui le rendent encore plus sournois :
● On se croit anonyme……et du coup, on ose des choses qu’on ne ferait jamais en face. Ça peut désinhiber, faire perdre toute empathie.
● On ne voit pas la réaction de l’autre : écran = distance. On ne voit pas si la personne pleure, panique ou se renferme. Du coup, on réalise rarement l’impact réel de nos actes.
● Ça va très vite : en un clic, une photo, un vidéo, un commentaire peuvent être vus, likés, partagés par des dizaines, voire des centaines de personnes.
● Ça touche un public immense, et même des inconnus peuvent s’y mêler, ce qui renforce le sentiment que « tout le monde est contre moi ».
● C’est presque impossible à arrêter : un contenu partagé peut rester en ligne des années, même si la personne qui l’a posté le regrette ensuite. La victime, elle, en subit encore les conséquences longtemps après…
Et maintenant ?
Tu l’as compris : le cyberharcèlement n’est pas un problème « virtuel », c’est un phénomène bien réel, aux conséquences parfois lourdes.
Mais surtout, ce n’est jamais une fatalité.
Dans les prochains articles, on va justement parler :
● des conséquences possibles du cyberharcèlement (mentales, physiques, sociales, scolaires…)
● et de ce qu’on peut faire si on en est victime, témoin ou auteur·rice
Voir aussi :
MAJ 2025